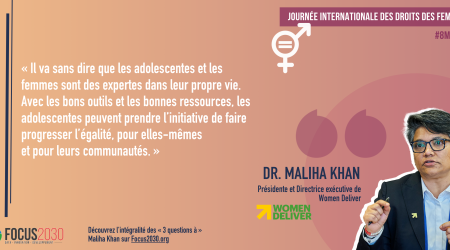| À l’occasion du 8 mars, journée intenationale des droits des femmes, Focus 2030 met en valeur l’action et l’expertise de celles et ceux qui se mobilisent quotidiennement pour l’égalité femmes-hommes dans le monde. Retrouvez notre dossier spécial. |
Entretien avec Fanny Petitbon, Responsable plaidoyer à CARE France
Focus 2030 : Les conséquences du changement climatique sur les populations et la planète font de plus en plus leur place dans le débat public. Il n’en est pas de même pour l’impact différencié qu’il a sur les femmes, pourtant plus exposées, comme l’ont mis en lumière de nombreuses études. Pouvez-vous nous expliquer en quoi les enjeux de justice climatique et des droits des femmes sont-ils liés, et pourquoi les femmes doivent être pleinement impliquées dans les décisions et solutions à mettre en œuvre face à cet enjeu planétaire ?
Fanny Petitbon : Avant de parler de justice climatique, il est important de rappeler que le changement climatique constitue l’une des plus grandes injustices de notre époque. Les 10% les plus riches de la population mondiale sont responsables de plus de la moitié des émissions de CO2 cumulées entre 1990 et 2015. Pendant ce temps-là, la moitié la plus pauvre de la population planétaire, vivant principalement dans les pays du Sud, n’a été à l’origine que de 7% des émissions de CO2. Et pourtant, ce sont les populations des pays du Sud qui subissent de plein fouet, et de manière disproportionnée, les impacts du changement climatique. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : sur les trente dernières années, 97 % du nombre total de personnes touchées par les conséquences des événements climatiques extrêmes (cyclones, inondations..) et 79 % des décès enregistrés l’ont été dans les pays en développement.
Or cette injustice climatique forme un cocktail explosif quand elle rencontre les inégalités de genre qui restent très présentes dans la vaste majorité des sociétés à travers le monde, y compris dans les pays du Sud. Les femmes et les filles continuent de faire face à des obstacles, en termes d’accès et de contrôle de la terre, des ressources financières, mais aussi à l’éducation, à l’emploi, à la technologie et aux processus de décision. Chez CARE, nous parlons donc d’une double injustice.
Très concrètement, le changement climatique contribue à une surcharge de travail et à une exposition accrue aux risques, pour les femmes et les filles. Ce sont elles qui parcourent des distances de plus en plus longues, pour trouver de l’eau et du bois de chauffe, des ressources naturelles de plus en plus rares en raison notamment de la déforestation et des sécheresses à répétition. C’est autant de temps qu’elles ne peuvent pas consacrer à leur éducation ou au développement d’activités économiques (petit commerce, agriculture..) limitant leur indépendance, ou à la participation aux cercles de décision à l’échelle locale. Ce sont elles aussi qui se privent en premier de nourriture quand une sécheresse ou une crise alimentaire survient. La surcharge de travail imposée aux familles, et aux mères en particulier, conduit à une augmentation de la déscolarisation précoce des filles afin qu’elles puissent prêter main forte au sein du foyer. Par ailleurs, la migration des zones rurales vers les zones urbaines, pour sécuriser de nouvelles sources de revenus, est une stratégie d’adaptation souvent utilisée par les hommes. Or cela entraîne une augmentation des violences basées sur le genre à l’encontre de leurs épouses ou de leurs sœurs, restées dans leur localité d’origine.
Au-delà de cette très sombre réalité, CARE a constaté dans les pays où elle intervient que les femmes jouent un rôle central dans la réponse à l‘urgence climatique en développant et diffusant des solutions créatives et efficaces : culture de semences plus résistantes aux sécheresses ou aux inondations, utilisation de foyers de cuisson améliorés, recours au compost pour remplacer les engrais chimiques. Valoriser et soutenir davantage leurs compétences et savoir-faire est essentiel et urgent, de même que reconnaître la complémentarité des rôles des femmes et des hommes dans la lutte contre le changement climatique.
Focus 2030 : Les enjeux climatiques et d’égalité de genre sont au cœur des projets menées par CARE. Comment agir et quelles actions mettez-vous en place pour contribuer à ces enjeux ?
Fanny Petitbon : Pour CARE, lutter contre le changement climatique et les inégalités femmes-hommes vont de pair. Notre travail au quotidien avec les communautés dans une centaine de pays à travers le monde nous conforte dans l’idée qu’il est possible de changer le cours des choses. En plaçant les populations locales, et en particulier les femmes et les populations autochtones souvent marginalisées, au cœur de nos programmes d’adaptation au changement climatique et de réduction des risques de catastrophes, notre action vise à renforcer durablement les capacités des communautés à rebondir mieux et plus rapidement face aux chocs climatiques qui se multiplient tels que les sécheresses, inondations et cyclones. Et ce faisant, nous veillons à rééquilibrer les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons.
Dans nos projets d’adaptation, nous développons cette approche en trois temps. Le premier est celui du diagnostic qui s’appuie à la fois sur les savoirs traditionnels et observations des populations locales mais aussi les données scientifiques rendues accessibles par les instituts météorologiques nationaux. Il s’agit pour les communautés de pouvoir analyser leurs vulnérabilités actuelles, les risques climatiques à venir ainsi que leurs capacités à s’y adapter, en prenant en compte les différences entre femmes et hommes. Mieux nous comprenons comment les rôles assignés aux individus en fonction de leur genre et les relations de pouvoir entre les sexes influencent le niveau de vulnérabilité de chacun·e et les options dont chacun·e dispose pour y faire face (accès et de contrôle des ressources naturelles, capacité à se déplacer librement ou à faire entendre sa voix), plus nos actions sont pertinentes.
Après ce moment qui sert souvent d’électrochoc, vient le temps de l’action, avec la mise en place d’un espace de dialogue entre femmes et hommes, représentant·e·s des communautés et des autorités (services décentralisés de ministères, élus locaux) et des leaders traditionnels et religieux pour développer des plans locaux d’adaptation et de réduction des risques, et définir qui fait quoi, avec quelles ressources. Cela permet de créer une réelle écoute, des liens de confiance et de faire entendre les voix et propositions de celles et ceux qui trop longtemps n’ont pas été jusque-là invité·e·s à la table des discussions.
Enfin, quand les actions d’adaptation et de réduction des risques ont prouvé leur efficacité à l’échelle locale, CARE mène en collaboration avec ses partenaires locaux des actions d’influence auprès des gouvernements pour que les modèles testés et approuvés soient inscrits dans les politiques nationales et déclinés à l’échelle du pays, pour améliorer les conditions de vie d’un maximum de personnes.
Au cours des dernières années, CARE France a ainsi pu fournir un appui spécifique à des petites agricultrices en Inde et Thaïlande mais aussi en Equateur et Madagascar, en les formant aux techniques agricoles durables et à l’occupation de fonctions de responsabilité. Les femmes ont ainsi pu participer activement aux organes locaux de décision, accéder plus facilement aux capitaux, marchés et services, et créer des canaux de soutien dans leurs communautés. Comparé aux villages n’ayant pas bénéficié de ces projets, le rôle des femmes dans les localités ciblées est perçu de manière plus positive, et les femmes ont gagné confiance en elles pour soulever des problèmes en public et jouer un rôle dans les prises de décisions à l’échelle locale.
Focus 2030 : Dans quelle mesure ces enjeux sont-ils débattus dans les instances internationales ? Y a-t-il eu des avancées significatives en la matière et quelles sont vos attentes pour les prochaines COP à venir, tout particulièrement la COP28 qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis ?
Fanny Petitbon : Oui, les enjeux croisés de genre et changement climatique sont clairement ancrés dans les négociations internationales sur le climat. La première décision de COP sur le sujet en 2001 se concentrait sur la manière d’augmenter le nombre de femmes dans les délégations gouvernementales assistant aux négociations climatiques (qui est malheureusement encore un sujet aujourd’hui puisqu’au rythme où vont les choses, la parité de genre ne sera pas atteinte dans les délégations gouvernementales aux COP avant 2040)... Le focus s’est déplacé une décennie plus tard sur comment mieux prendre en compte les enjeux de genre dans les politiques d’adaptation, le développement et le transfert de technologies mais aussi les financements climat. Puis, on a observé un coup d’accélérateur sur le sujet entre 2012 et 2015, notamment grâce à la force du plaidoyer d’une poignée de gouvernements et la constituante « femmes et genre » de la CCNUCC. Dès 2012, le genre est devenu est un point permanent à l’ordre du jour des COPs. En 2014, la COP adopte pour la première fois un programme de travail sur le genre puis c’est la consécration avec l’accord de Paris signé en décembre 2015 dont le préambule acte la nécessité pour les pays signataires de s’assurer que l’action climatique qu’ils mettent en oeuvre respecte un certain nombre de principes-clé comme les droits humains mais aussi l’égalité de genre. En 2017, la COP adopte son premier plan d’action genre. En 2019, un programme de travail renforcé sur le genre d’une durée de 5 ans accompagné de son plan d’action est adopté. La pandémie a ensuite sérieusement freiné la mise en œuvre de ces engagements, toujours valables en 2023.
Alors que le résultat des négociations sur le genre à la COP27 en Egypte a été très décevant, tous les yeux sont désormais tournés vers la COP28 à Dubaï. L’un des enjeux majeurs de cette COP sera le premier exercice de Bilan mondial, le mécanisme décidé à Paris en 2015 pour s’assurer de réaliser un point d’étape tous les 5 ans sur la mise en œuvre des engagements pris par les Etats en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’adaptation, de pertes et dommages, de financements climat… C’est un moment-clé pour créer un sursaut car les politiques climatiques actuelles ne nous mettent pas du tout sur la bonne trajectoire pour rester sous 1,5°c de réchauffement climatique.
Le bilan qui s’annonce mauvais doit créer un électrochoc pour que les gouvernements revoient à la hausse l’ambition de leurs plans climat (ou « Contributions Déterminées au niveau National »), notamment en y intégrant davantage les enjeux de genre.
En 2020, une analyse de l’ONG WEDO démontrait que plus de la moitié des plans climat des Etats ne contenait aucune référence au genre. En 2021, CARE mettait en évidence que les Etats les plus ambitieux sur la question étaient des pays du Sud (Cambodge, Kenya, Papouasie Nouvelle Guinée, Iles Marshall). Un autre enjeu majeur de cette COP sera l’opérationnalisation du fonds sur les pertes et dommages, une demande portée par les pays les plus vulnérables. Il sera essentiel que la structure et les principes du fonds ainsi que son modèle de gouvernance, prennent pleinement en compte les enjeux de genre, et notamment facilitent l’accès des associations de défense des droits des femmes ou pilotées par des femmes aux financements.
En 2023, CARE continuera à se mobiliser pleinement pour que ces actrices, en première ligne de la réponse à l’urgence climatique, soient systématiquement associées aux processus de décision liées au climat du local à l’international, mais aussi soient davantage soutenues. Le temps des grands discours est révolu : la diplomatie féministe dont de plus en plus de gouvernements, dont la France, se réclament doit s’incarner dans des actes forts.
NB : Les opinions exprimées dans cet entretien sont celles de l’interviewée et ne reflètent pas nécessairement les positions de Focus 2030.
| Consultez ce lien pour découvrir le dossier droits des femmes de Focus 2030 dans son intégralité. |
 Replier le menu
Replier le menu

 Abonnez-vous à la newsletter
Abonnez-vous à la newsletter