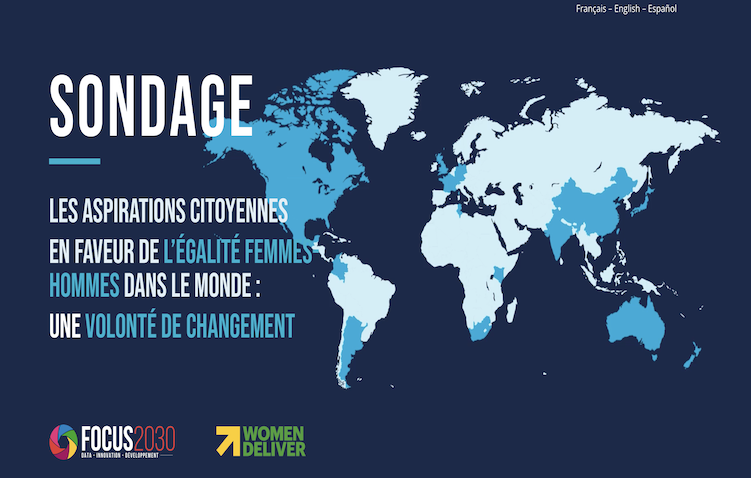Édito
Année après année, et en dépit des discours, les inégalités entre les femmes et les hommes persistent. Selon les Nations unies, il faudrait encore patienter 300 ans pour atteindre l’égalité de genre à l’échelle du monde au rythme des progrès actuels.
Ces inégalités structurelles sont aujourd’hui exacerbées par la multiplication des crises dans le monde – conflits armés, crises économiques, catastrophes climatiques – et par le recul des droits pourtant durement acquis.
Dans ce contexte, la « diplomatie féministe » ou « politique étrangère féministe » s’affirme comme un levier stratégique en plaçant les droits des femmes et l’égalité de genre au cœur des actions diplomatiques et de coopération internationale, des instruments de paix, de stabilité et de développement durable.
Dans le contexte actuel de backlash généralisé vis-à-vis des droits des femmes et des minorités sexuelles observé sur les cinq continents, la diplomatie féministe adoptée par un nombre grandissant de gouvernements a le potentiel de changer la donne et faire face aux mouvements conservateurs et anti-droits qui cherchent à remettre en cause les acquis des dernières décennies.
Encore faudrait-il que les moyens alloués à cette politique soient à la hauteur de l’ambition affichée. Car les financements demeurent très en deçà des besoins. Selon ONU Femmes, 420 milliards de dollars par an seraient nécessaires pour combler les inégalités de genre dans les pays en développement- une fraction des 2 700 milliards de dollars dépensés chaque année en matière de défense.
C’est dans ce contexte que la France organise, les 22 et 23 octobre 2025 à Paris, la 4ᵉ Conférence ministérielle des diplomaties féministes. Gouvernements, organisations internationales, acteurs philanthropiques, société civile et mouvements féministes se réuniront pour « résister, unir et agir » et ainsi réaffirmer l’importance des droits des femmes, renforcer les coalitions internationales et traduire les engagements en actions concrètes et financées.
Cette conférence intervient à un moment charnière : 2025 marque à le fois le 30ᵉ anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Pékin, les 25 ans de la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, et les 80 ans des Nations unies, autant d’occasions de mesurer le chemin parcouru et celui qu’il reste à accomplir.
Découvrez notre décryptage des enjeux et défis de la diplomatie féministe : état des lieux des inégalités de genre dans le monde, financement de l’égalité femmes-hommes, initiatives et mobilisation des acteurs de la société civile, moments clés de la 4ᵉ Conférence ministérielle.
Sommaire
- La 4ᵉ conférence ministérielle des diplomaties féministes : un rendez-vous international pour faire avancer l’égalité de genre
- Qu’est-ce que la diplomatie féministe ?
- Résistances et mouvements anti-droits : un défi global
- Cadre international des droits des femmes
- État de l’égalité de genre dans le monde : faits et chiffres
- Qui finance l’égalité femmes-hommes ?
- Mobilisation et attentes des acteurs de la 4ᵉ conférence ministérielle des diplomaties féministes
La 4ᵉ conférence ministérielle des diplomaties féministes : un rendez-vous international pour faire avancer l’égalité de genre
Les 22 et 23 octobre 2025, la France accueillera à Paris la 4ᵉ Conférence ministérielle des diplomaties féministes, un événement international majeur pour réaffirmer la nécessité de défendre et promouvoir les droits des femmes et l’égalité de genre, face à la persistance des inégalités et à la montée des mouvements anti-droits.
L’édition 2025 à Paris réunira les États engagés, des organisations internationales, des banques de développement, des mouvements féministes, des acteurs de la recherche et des fondations philanthropiques. L’agenda combine plénières ministérielles et tables-rondes multi-acteurs, afin de :
- Réaffirmer l’importance des droits des femmes et de l’égalité de genre comme impératif universel.
- Renforcer et élargir les coalitions internationales pour protéger et promouvoir ces droits.
- Favoriser une diplomatie féministe coordonnée et ambitieuse, avec des engagements concrets des États, organisations internationales, société civile et fondations philanthropiques.
La conférence aboutira par l’adoption d’une déclaration politique.
A propos des Conférences ministérielles sur les diplomaties féministes :Les Conférences ministérielles sur les diplomaties féministes sont des événements internationaux réunissant États, organisations internationales, société civile, acteurs philanthropiques et académiques autour de l’égalité de genre et des droits des femmes. Ces conférences offrent un cadre pour :
La première conférence a été initiée par l’Allemagne en 2022, suivie des Pays-Bas en 2023 et du Mexique en 2024. Chaque édition vise à créer un moment multilatéral unique en dehors du cadre onusien, permettant de travailler avec des pays partageant des priorités communes, d’avancer sans blocage et de faire émerger des engagements concrets et mesurables. |
Plus d’informations disponibles sur le site officiel de la conférence.
Les événements en marge de la conférence
En marge de la Conférence ministérielle, plusieurs événements seront organisés à Paris pour amplifier la mobilisation et favoriser les échanges entre experts, décideurs et société civile :
- Forum “Avec Nous, pour toustes” – 21 octobre 2025, Siège de l’Agence française de développement, Paris 12ᵉ – 9h-22h. Tables rondes et échanges avec activistes des Suds et associations partenaires sur justice économique, justice climatique, lutte contre les violences de genre et droits sexuels et reproductifs. Soirée festive, remise du prix genre et climat et projection du documentaire « La liberté est ma cause ». Inscriptions.
- Lancement du livre “Mundializar la Igualdad” – 21 octobre 2025, Le Carré Edouard VII, Paris 9ᵉ – 14h-15h30. Organisé par le Center for Feminist Foreign Policy avec Feministas Sin Fronteras Política Exterior, Feminista et CLACSO. Événement hybride avec interprétation en espagnol, anglais et français. Inscriptions.
- Conférence “Beyond the Headlines : The State of Feminist Foreign Policy Today” – 21 octobre 2025, Le Carré Edouard VII, Paris 9ᵉ – 16h-19h. Lancement du rapport “Defining Feminist Foreign Policy 2025” du Center for Feminist Foreign Policy suivi d’une réception. Événement hybride, enregistrement disponible après l’événement avec sous-titres multilingues. Inscriptions.
- Conférence “Pérenniser notre diplomatie féministe : garantir les droits, soutenir la société civile” – 22 octobre 2025, Hôtel de Lassay, Paris 7ᵉ – 8h30-12h. Organisée par la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, et réunis sous le haut-patronage de Yaël Braun-Pivet, Présidente de l’Assemblée nationale, responsables politiques, organisations internationales, société civile et chercheuses débattront de la protection des droits, du soutien aux sociétés civiles et de la lutte contre le masculinisme. Inscriptions.
- Conférence “Financing for Gender Equality and Feminist Foreign Policies : Innovation, Investments and Challenges” – 22 octobre 2025 – Sciences Po, Paris 7ᵉ – 8h30-10h. Organisé par le Center for Feminist Foreign Policy avec l’Alliance for Feminist Movements, lancement du rapport “Feminist Foreign Policy and Development Finance for Gender Equality : Momentum Under Threat ?” Inscriptions.
- Conférence “ Sharing Regional Best Practices to Localize Feminist Foreign Policies ” – 22 octobre 2025, Novotel Paris Centre Tour Eiffel, Paris 15ᵉ – 10h15–12h00. Organisé par l’International Peace Institute (IPI), en partenariat avec ONU Femmes et le Réseau mexicain pour la diplomatie féministe, avec le soutien des Open Society Foundations (OSF). Évènement en anglais. Inscriptions.
Programme des évènements parallèles
QU’EST-CE QUE LA DIPLOMATIE FÉMINISTE ?
Une approche globale des relations internationales
La diplomatie féministe, ou politique étrangère féministe, est une approche renouvelée des relations internationales qui place les droits des femmes et l’égalité de genre non pas comme un accessoire mais comme un pilier de l’action extérieure d’un État. Elle englobe l’ensemble des domaines — diplomatie, commerce, sécurité, développement, numérique, climat, gouvernance — et transforme la façon même de concevoir la politique étrangère dans le but de corriger les inégalités systémiques et intégrer une perspective féministe dans les décisions politiques et financières.
Initiée en 2014 par la Suède sous l’impulsion de sa ministre des Affaires étrangères Margot Wallström, elle a depuis été adoptée par une quinzaine de pays, et se structure autour de principes communs : garantir les droits, mobiliser les ressources, assurer la représentation des femmes et des filles dans toutes les sphères de la société. Cette politique diffère d’une politique étrangère traditionnelle car elle exige cohérence et transversalité : l’égalité de genre n’est plus un domaine parmi d’autres, mais un prisme à travers lequel sont conçus et mis en œuvre l’ensemble des décisions et des instruments extérieurs.
Si ces piliers constituent un socle partagé, chaque pays définit sa propreconception et ses priorités selon son histoire, ses institutions et son contexte géopolitique. Le Canada met l’accent sur l’aide internationale, le Mexique sur la participation citoyenne et la lutte contre les violences de genre, l’Espagne sur l’intersectionnalité et l’action européenne. En France, la Stratégie internationale pour une diplomatie féministe 2025-2030 consolide les priorités historiques, telles que l’égalité dans et par l’éducation et la lutte contre toutes les formes de violences, tout en introduisant de nouvelles priorités liées aux enjeux contemporains, comme le numérique, le climat et les crises internationales.
Pour favoriser les échanges d’expériences et l’apprentissage collectif, plusieurs États se sont regroupés au sein du réseau Feminist Foreign Policy Plus (FFP+), qui vise à mutualiser les bonnes pratiques, renforcer la coordination diplomatique et consolider une approche commune face au recul global des droits des femmes et des filles. Ce réseau illustre la volonté de faire de la diplomatie féministe un espace de coopération internationale plutôt qu’une simple juxtaposition d’initiatives nationales.
La diplomatie féministe agit donc moins comme un modèle unique que comme un cadre de référence commun, souple et évolutif, permettant à chaque pays d’adapter ses instruments et d’enrichir la réflexion collective par le partage d’expériences.
Mais la diplomatie féministe ne doit pas se limiter à un symbole : elle doit se traduire par des engagements concrets, de la budgétisation à la mobilisation internationale, pour protéger et promouvoir les droits des femmes et des filles. Dans un monde traversé par des crises climatiques, géopolitiques et sociales, adopter une diplomatie féministe doit servir à poser l’égalité de genre non comme une valeur additionnelle, mais comme un levier stratégique de stabilité, de coopération et de progrès partagé.
Résistances et mouvements anti-droits
Mais ce mouvement rencontre aussi des résistances. Le contexte international est marqué par une montée en puissance des mouvements « anti-droits » et « anti-genre, » qui cherchent à remettre en cause les droits acquis des femmes et des personnes LGBTQI+, en particulier les droits et la santé sexuels et reproductifs (DSSR).
Ces acteurs, souvent issus d’alliances entre groupes religieux fondamentalistes, organisations conservatrices et partis d’extrême droite, coordonnent leurs positions et investissent les espaces de décision et de négociation, à toutes les échelles : nationale, régionale, transnationale et multilatérale. Ils visent à affaiblir le langage des résolutions et des cadres normatifs sur les droits humains, à réduire les financements destinés à l’égalité de genre et à promouvoir une conception restrictive de la famille et du rôle des femmes.
Cette stratégie s’incarne notamment dans la Déclaration de consensus de Genève, signée en 2002 par 36 États et réaffirmée depuis par l’administration américaine sous le deuxième manqdat de Donald Trump. Présentée comme un texte en faveur de la santé des femmes et du renforcement de la famille, elle s’oppose en réalité à la reconnaissance du droit à l’avortement et aux droits des minorités sexuelles. Plusieurs États signataires continuent de s’en réclamer dans les forums internationaux.
En Europe, selon le rapport The Next Wave du European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights (EPF, juin 2025), 275 acteurs anti-droits sont aujourd’hui identifiés, contre une cinquantaine en 2018. Leurs financements cumulés entre 2019 et 2023 atteignent 1,18 milliard de dollars, dont plus de la moitié provient de 28 pays européens, suivis de la Fédération de Russie et d’organisations basées aux États-Unis. Ce réseau transnational vise explicitement à freiner les politiques d’égalité de genre et à capter les leviers institutionnels sous couvert de « tradition » et de « dignité humaine ».
Ces mouvements bénéficient d’un ancrage politique croissant, avec des partis populistes ou conservateurs qui reprennent leurs rhétoriques anti-égalité pour polariser l’électorat et affaiblir la cohésion démocratique. Le recul de certains gouvernements historiquement engagés accentue cette fragilisation. Même la Suède, pionnière de la diplomatie féministe, a mis fin à sa politique étrangère féministe en 2022 à la suite d’un changement de majorité.
Parallèlement, la baisse des financements dédiés aux DSSR, due en majorité à la réactivation du « Global gag rule » et le démantèlement de l’USAID par le gouvernement Trump II, a des conséquences directes : selon l’Institut Guttmacher, 11,7 millions de femmes pourraient être privées d’accès à la contraception, entrainant 4,2 millions de grossesses non désirées et 8 340 décès liés à des complications durant la grossesse et l’accouchement en 2025, sur la base des tendances mondiales.
Ces offensives coordonnées révèlent une réalité politique plus profonde : les attaques contre les droits des femmes et des minorités ne sont pas des débats de société isolés, mais des attaques contre la démocratie elle-même.
Les mouvements anti-droits utilisent les questions liées au genre, à la sexualité ou à la famille comme prétextes pour polariser, diviser et délégitimer les institutions démocratiques. En affaiblissant les droits individuels et les libertés publiques, ils participent à la consolidation de régimes autoritaires et à l’érosion de la gouvernance multilatérale fondée sur les droits humains universels.
Dans ce contexte, la diplomatie féministe apparaît plus nécessaire que jamais : non seulement comme un levier de défense des droits fondamentaux, mais aussi comme un outil stratégique de résilience démocratique et de coopération internationale face aux mouvements autoritaires et réactionnaires.
Cadre international des droits des femmes
Les politiques étrangères féministes s’appuient sur plus de trois décennies de mécanismes normatifs et d’engagements internationaux en faveur des droits des femmes et de l’égalité de genre, qui définissent standards et lignes directrices pour les États. En 2025, alors que le monde célèbre le 30e anniversaire de la Déclaration de Pékin, ces standards fournissent un cadre de référence pour orienter les politiques étrangères et mesurer les progrès. Les Objectifs de développement durable, en particulier l’ODD 5, viennent renforcer cet agenda mondial, en intégrant l’égalité femmes-hommes et l’autonomisation des femmes et des filles comme priorités transversales dans tous les domaines de l’action internationale.
Focus sur la résolution 1325 et l’agenda Femmes, Paix et Sécurité (WPS)
Adoptée à l’unanimité en 2000 par le Conseil de sécurité des Nations unies, la résolution 1325 est la première à reconnaître le rôle central des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, ainsi que dans la consolidation de la paix. Elle repose sur quatre piliers : la participation des femmes, leur protection, la prévention de la violence basée sur le genre et la réponse humanitaire. Cette résolution a donné naissance à l’agenda « Femmes, Paix et Sécurité », visant à intégrer systématiquement les femmes dans les processus de paix et à renforcer leur rôle dans la sécurité mondiale.
ÉTAT DE L’ÉGALITÉ DE GENRE DANS LE MONDE : FAITS ET CHIFFRES
Trente ans après la Déclaration et le Programme d’action de Pékin, les progrès vers l’égalité femmes-hommes demeurent fragiles et inégaux. Si des avancées notables ont été réalisées dans l’accès à l’éducation, la santé ou la participation politique, les inégalités persistantes continuent de peser lourdement sur les sociétés et sur le développement durable. Près d’une jeune femme sur cinq est encore mariée avant l’âge de 18 ans, interrompant prématurément son éducation et limitant son autonomie. Une femme sur huit, âgée de 15 à 49 ans, a subi des violences de la part de son partenaire au cours de la dernière année.
Les femmes sont également en première ligne face aux crises globales : les conflits, les catastrophes climatiques et les chocs économiques accentuent leur vulnérabilité. Le changement climatique pourrait plonger 158 millions de femmes supplémentaires dans la pauvreté d’ici 2050, dont près de la moitié en Afrique subsaharienne.
DES FINANCEMENTS INSUFFISANTS POUR PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES GENRES À L’INTERNATIONAL
Dans un contexte mondial marqué par la multiplication des crises et la montée des mouvements anti-droits, les financements destinés à l’égalité de genre restent largement insuffisants : ONU Femmes estime à 420 milliards de dollars par an les investissements nécessaires pour combler les écarts, soit une fraction des 2 700 milliards de dollars dépensés chaque année pour la défense militaire.
Quels pays donateurs soutiennent l’égalité femmes-hommes dans leur aide publique au développement ?
Depuis la mise en place par l’OCDE en 2016 d’un marqueur dédié à la comptabilisation de l’aide publique au développement en faveur du genre, les 32 pays donateurs du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE indiquent le degré de prise en compte du genre dans l’ensemble de leurs projets et programmes.
Malgré la reconnaissance croissante du rôle central de l’égalité de genre dans le développement durable et la stabilité mondiale, les ressources financières allouées demeurent largement insuffisantes. En moyenne, entre 2022 et 2023, les 32 pays donateurs du CAD et les institutions de l’Union européenne se sont collectivement engagés à orienter 71,9 milliards de dollars US par an, soit 45,9 % de leur aide publique au développement (APD) bilatérale, vers l’égalité femmes-hommes et l’autonomisation des femmes et des filles.
Sur ce total, 6 milliards de dollars — soit 3,9 % de l’APD bilatérale — ciblaient l’égalité comme objectif principal (marqueur 2 de l’OCDE), tandis que 65,9 milliards de dollars — 42 % de l’APD — soutenaient des projets où l’égalité constituait un objectif significatif (marqueur 1).
Après cinq ans de hausse de leur budget alloué à la coopération internationale, les 33 membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE ont enregistré en 2024 un recul historique de leur APD, qui s’est élevée à 212,1 milliards de dollars, soit une baisse de 7,1 % par rapport à 2023. En Europe, 20 pays donateurs et l’Union européenne prévoient en 2025 une réduction totale de 11,8 milliards de dollars par rapport à 2024, dont 5,2 milliards pour l’Allemagne et 2,6 pour la France. L’OCDE estime que l’APD des membres du CAD pourrait reculer de 9 à 17 % entre 2024 et 2025, menaçant notamment les financements en faveur de l’égalité femmes-hommes.
Des financements pour les mouvements féministes en danger
Malgré leur rôle crucial, les organisations féministes reçoivent un soutien d’à peine 0,7 milliard de dollar par an, soit moins de 1 % de l’APD dédiée à l’égalité de genre. En 2023, le montant total alloué par les membres du CAD de l’OCDE aux organisations et mouvements féministes s’élevait à 797 millions de dollars.
Les réductions massives de financements internationaux menacent aujourd’hui le tissu associatif féministe mondial. Selon l’enquête At a breaking point d’ONU Femmes, 90 % des 411 organisations féministes actives dans 44 pays en crise subissent les effets de la baisse de l’aide. Plus de 60 % ont déjà dû réduire leurs interventions, tandis que 47 % risquent de fermer dans les six prochains mois. Parallèlement, 72 % des organisations ont dû licencier du personnel, fragilisant davantage leur capacité à soutenir les femmes et les filles, particulièrement touchées par les conflits et les crises humanitaires — du Myanmar à la Palestine, en passant par le Soudan et l’Afghanistan.
Ces contraintes financières s’ajoutent à une précarité structurelle : en 2023, les organisations féministes et de défense des droits des femmes disposaient d’un budget médian annuel de seulement 22 000 USD. Derrière ce chiffre se cache une grande disparité : quelques organisations accèdent à des ressources importantes, mais la grande majorité survit avec des budgets très limités, ce qui accentue les inégalités et limite la portée de leurs actions.