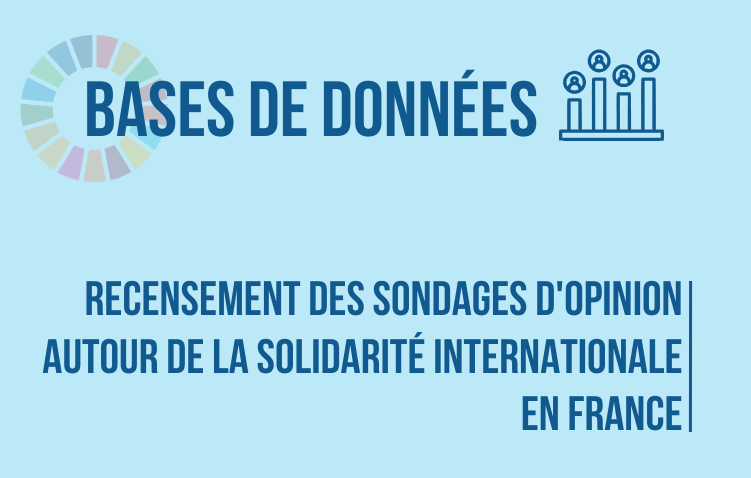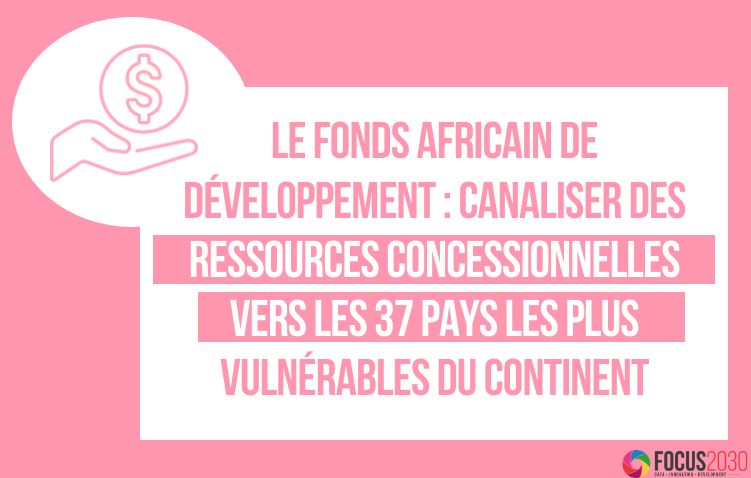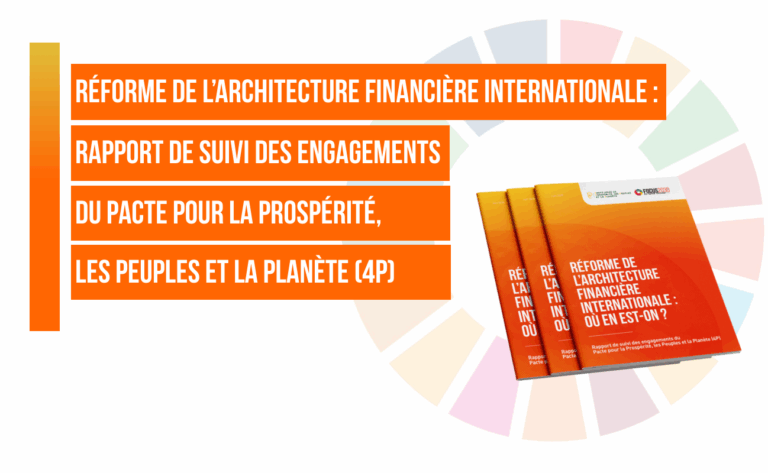Augmentation de l’aide publique au développement en 2022
Publié le 22/01/2024, modifié le 25/07/2025.
| Cet article présente les montants de l’aide publique au développement des principaux bailleurs de l’OCDE en 2022. Pour connaître les dernières statistiques disponibles, consulter cet article |
L’OCDE a publié, le 22 janvier 2024, les données définitives des montants alloués par les pays donateurs à l’aide publique au développement (APD) pour l’année 2022.
L’APD émise par les membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE s’est élevée à un montant historique de 211 milliards de dollars US en 2022, soit 0,37 % du revenu national brut combiné des pays du CAD. C’est le plus haut niveau jamais atteint. Décryptage.
L’APD atteint un nouveau sommet en 2022
En 2022, l’APD des pays du CAD a atteint 210,7 milliards de dollars (environ 200 milliards d’euros au taux de change de 2022), soit une augmentation de 17 % en termes réels par rapport à 2021.
Cette augmentation est toutefois largement due à la hausse des dépenses consacrées à l’accueil des réfugiés dans les pays donateurs, qui ont atteint 31 milliards de dollars (contre 13 milliards en 2021, soit une hausse de 147 % en termes réels) ou 14,6 % de l’APD totale des pays membres du CAD, un record. Si l’on exclut ces dépenses, l’APD totale a augmenté de 7,3 % en termes réels par rapport à 2021, et elle a diminué dans dix pays.
La hausse de l’APD en 2022 est également entraînée par l’essor du soutien à l’Ukraine à la suite de son invasion par la Russie (8,4 % de l’APD totale, ou 17,6 milliards de dollars, comparés à 922 millions l’année précédente). Par ailleurs, si les dépenses liées à l’appui d’activités de lutte contre la pandémie de Covid-19 ont reculé de 33 % par rapport à 2021, elles représentent toujours 6,8 % de l’APD totale (14,4 milliards).
En outre, le soutien aux pays les plus pauvres de la planète (pays les moins avancés ou PMA) a diminué de 4 % entre 2021 et 2022, une baisse principalement entraînée par un moindre soutien à la réponse de ces pays au Covid-19. En moyenne, le soutien aux PMA a diminué d’une moyenne de 31 % de l’APD totale entre 2010 et 2021 à 23 % en 2022. En dépit de la cible d’allouer 0,08 % du RNB des membres du CAD aux PMA, seuls quatre pays respectent cet engagement.
Cette somme équivaut à 0,37 % du revenu national brut (RNB) combiné des pays du CAD. Si ce ratio n’avait pas été atteint depuis 1982, il demeure toutefois bien inférieur à l’objectif de 0,7 % du RNB adopté en… 1970 par les pays industrialisés auprès des Nations unies.
Seuls le Luxembourg, la Suède, la Norvège et l’Allemagne allouent au moins 0,7 % de leur richesse nationale à la solidarité internationale. Il est cependant à noter que 21 des 30 pays du CAD ont augmenté le montant de leur APD par rapport à 2021, dont certains de façon conséquente : la Pologne et l’Irlande (+268 % et +121 %, respectivement, en raison d’une forte augmentation du coût de l’accueil des réfugiés sur leurs territoires, mais aussi d’une hausse de leurs contributions aux organisations internationales), ou encore la Lituanie (+173 %, en raison de l’accueil des réfugiés sur son territoire ainsi que de son soutien à l’Ukraine).
Dans l’ensemble, l’APD pour des projets et programmes bilatéraux et la coopération technique a augmenté de 19 % par rapport à 2021, tandis que les contributions des membres du CAD aux budgets des organisations multilatérales a diminué de 5 %.
Une hausse de l’APD depuis l’adoption des Objectifs de développement durable
Depuis 2017, l’APD nette a augmenté de 35 %. Elle a régulièrement augmenté entre 2013 et 2016, où elle a atteint un premier sommet sous l’effet en particulier de l’afflux de réfugiés en Europe, et aux coûts des réfugiés dans les pays donneurs qui y sont associés. En 2017, 2018 et 2019, elle a diminué en raison de l’amenuisement des dépenses liées aux réfugiés. En 2020, puis 2021 et 2022, l’APD a atteint son niveau le plus haut jamais enregistré, sous l’effet notamment du soutien apporté dans le contexte de la crise Covid‐19 ainsi que de la guerre en Ukraine et de ses conséquences pour les populations déplacées.
La France, quatrième pays donateur en volume mais dixième en proportion de son RNB
En 2022, l’aide publique au développement de la France a augmenté de 13 % par rapport à 2021, atteignant 16 milliards de dollars (environ 15,2 milliards d’euros). Ce montant représente 0,56 % de son RNB, en adéquation avec la trajectoire envisagée en 2018 par le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement.
Selon l’OCDE, cette hausse française est principalement due à un fort accroissement de son aide à destination de l’Afrique subsaharienne, ainsi que du coût de l’accueil des réfugiés sur son territoire (qui représente 9,4 % de l’APD de la France en 2022). La France a également consacré 2,9 % de son APD en soutien à l’Ukraine. Par ailleurs, le partage de doses de vaccins en excédent de son approvisionnement domestique représente 1,7 % du total.
En dépit de cette augmentation, la France se situe encore loin de l’objectif des 0,7 %. Si elle se place au 4e rang des pays donateurs en volume après les États-Unis, l’Allemagne et le Japon, elle recule au 10e rang en proportion de son revenu national brut.
Pour aller plus loin, découvrez les chiffres finaux de l’APD en 2022.